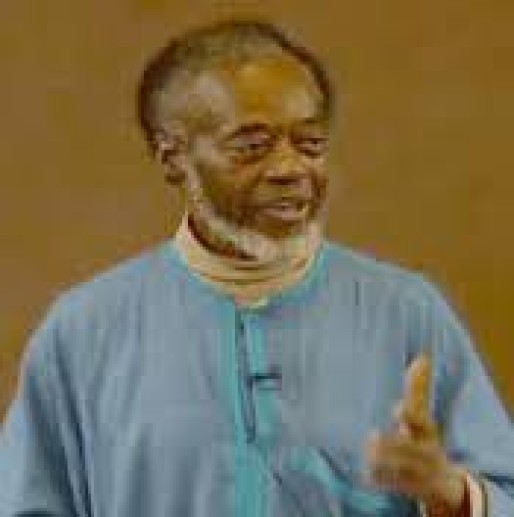
La postérité de la théologie de la libération de Jean-Marc Ela
Jean-Marc Éla (1936–2008), prêtre, théologien et sociologue camerounais, figure majeure de la pensée chrétienne africaine contemporaine, a profondément transformé l’approche théologique sur le continent. Porte-voix des sans-voix, intellectuel engagé et homme de terrain, il a su incarner une théologie au service de la dignité, de l’autonomie et de la libération des peuples africains.
Aujourd’hui, près de deux décennies après sa disparition, la postérité de sa théologie de la libération reste vive dans les débats intellectuels, les mouvements ecclésiaux alternatifs et les luttes sociales pour la justice. Ce blog explore les grands axes de cette postérité : comment l’œuvre de Jean-Marc Éla continue-t-elle d’inspirer, de questionner, et d’alimenter la quête d’une Église réellement au service des pauvres et des opprimés ?
1. Une théologie de terrain, au plus près des souffrances du peuple
Jean-Marc Éla n’est pas un penseur de cabinet : sa théologie est incarnée, née de l’observation, de l’écoute et du partage des conditions de vie des populations rurales camerounaises. Il a vécu dans les villages montagnards de l’Adamaoua, au milieu des paysans, partageant leurs luttes pour la survie.
De là naît sa conviction centrale : Dieu parle dans l’histoire des opprimés. L’Évangile, pour lui, ne peut être dissocié des combats pour la justice sociale, l’émancipation économique et la libération culturelle. Sa théologie part donc « d’en bas », à partir de la réalité quotidienne des pauvres.
2. La Bible relue à partir de l’Afrique
L’une des grandes innovations d’Éla est sa méthode herméneutique : il invite à relire les textes bibliques à la lumière de l’histoire et des souffrances africaines. Il ne s’agit pas d’appliquer mécaniquement des modèles exogènes, mais de découvrir dans l’Écriture la force d’émancipation que recèlent les récits de libération (Exode, Prophètes, Jésus de Nazareth).
Ce regard critique devient un outil de conscientisation : il ouvre la voie à une lecture populaire de la Bible, libérée du monopole clérical et mise au service des luttes locales. C’est l’intuition de la "Bible dans la case", où la Parole de Dieu devient accessible, partagée, discutée en communauté.
3. Contre les dogmes imposés : une Église à décoloniser
Jean-Marc Éla pose un diagnostic sévère sur l’institution ecclésiale : selon lui, l’Église en Afrique reste largement une importation coloniale, prisonnière de structures hiérarchiques étrangères aux logiques communautaires africaines.
Il appelle à une décolonisation de la foi, qui passe par :
L’inculturation authentique, non folklorique ;
La remise en cause de l’autorité verticale et patriarcale ;
La valorisation des langues africaines, des sagesses ancestrales et des formes locales de spiritualité.
Sa critique ne vise pas la foi, mais sa forme institutionnelle, souvent éloignée du message radical du Christ. Il rejoint ici d’autres penseurs africains (comme Kä Mana, Fabien Eboussi-Boulaga, Bénézet Bujo) dans une quête de libération spirituelle du continent.
4. Une théologie politique, tournée vers la transformation sociale
La postérité d’Éla est aussi politique. Il a dénoncé sans relâche les dictatures africaines postcoloniales, la complicité de certains clercs avec les régimes autoritaires, et l’instrumentalisation de la religion au service du pouvoir.
Sa théologie devient alors un outil de résistance : elle soutient les mouvements sociaux, les communautés en lutte, les jeunes en quête de sens. À l’heure où les inégalités explosent, où les États échouent à répondre aux besoins fondamentaux, la voix d’Éla résonne comme un appel à refuser toute forme de résignation.
5. Une pensée transversale : foi, science et société
Ce qui distingue profondément Jean-Marc Éla de nombreux théologiens, c’est son intégration de la sociologie, de l’économie, de la politique et de la culture dans la réflexion théologique.
Il ne compartimente pas. Il pense que l’Évangile doit interroger les structures agricoles, les systèmes éducatifs, les modèles de développement, et les rapports de genre.
Cette approche interdisciplinaire annonce déjà les exigences d’une théologie du XXIe siècle : ancrée, critique, ouverte au dialogue avec les sciences humaines et attentive aux mutations du monde.
6. La postérité actuelle : vers une Église en sortie
Aujourd’hui, la pensée de Jean-Marc Éla inspire :
Des communautés de base qui se structurent autour de la parole partagée et de la solidarité ;
Des mouvements jeunes en Afrique francophone qui interrogent les formes de domination spirituelle ;
Des théologiens africains qui poursuivent la réflexion sur l’émancipation par la foi, en dialogue avec les problématiques contemporaines : migration, environnement, genre, intelligence artificielle, etc.
Même au sein de l’Église catholique officielle, certains discours du pape François (notamment dans Evangelii Gaudium ou Fratelli Tutti) semblent rejoindre, en filigrane, les intuitions prophétiques d’Éla sur une Église pauvre, servante, décentralisée et engagée.
Conclusion : Éla, prophète de notre temps
La postérité de la théologie de la libération de Jean-Marc Éla ne se mesure pas uniquement dans les bibliothèques, mais dans la vitalité de ceux et celles qui, aujourd’hui encore, vivent leur foi comme engagement pour la justice, la dignité et la transformation sociale.
Son héritage invite chaque chrétien africain – et chaque intellectuel engagé – à se poser une question simple mais décisive :
De quelle manière ma foi libère-t-elle concrètement mon peuple ?
En cela, Jean-Marc Éla reste un prophète debout dans la conscie